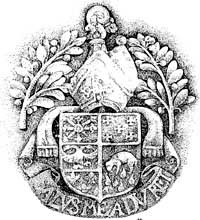- Description du jeton
Il s'agit d'un jeton en cuivre de belle facture décrit par Van Hende sous le N°582 dans son ouvrage La Numismatique Lilloise. En voici la description:
Av. S. EVERARDUS FUNDATOT CYSONI, Ecu de gueules (le jeton porte l'azur) à un rai d'escarboucle, timbré de la couronne du comte. Devise: UNANIMITER.
Rev. GETS. DE LABBAYE DE CYSOING 1661, Ecu d'or à trois pieds de sable, timbré d'une mitre et d'une crosse. Devise: PEDETENTIM.
| Ce jeton frappé en 1661 porte à l'avers les armoiries de l'abbaye avec le rais d'escarboucle. Sur une pierre proche des anciens bâtiments, on retrouve ce signe héraldique associé à l'aigle impérial, aux trois fleurs de lys et à l'Agneau pascal. Le jeton porte de nom d'Evrard, le fondateur de l'Abbaye avec la devise "Tous ensemble". |
| Au revers, le jeton porte d'après Van Hende les armoiries de l'Abbé VRAUX. La devise "en marchant avec sagesse" fait sans doute allusion à la personnalité d'un abbé reconnu pour sa prudence et ses qualité morales. |
D'après une note additive de Van Hende, ce jeton aurait été frappé à l'occasion de la translation faîte le 28 juillet 1661 d'un os du bras de Saint Evrard à la collégiale Saint Pierre de Lille.
Sur le linteau proche de la pyramide de Fontenoy, on peut voir un écusson composé du rais d'escarboucle de l'abbaye, de l'aigle impérial (autorité civile de l'époque), des trois fleurs de lys du diocèse de Reims, de la pierre d'autel et de l'Agneau pascal avec le millésime 1632. Sous l'écusson, on lit la devise SALUS MEA DURET.
- Sa naissance
- L'abbaye sous PHILIPPE AUGUSTE
- L'abbaye du 13è au 17è siècle
- L'abbaye sous LOUIS XV
- L'agonie
- La pyramide Fontenoy
Cysoing est une fort ancienne localité située au contact de petits pays naturels. Le premier est le Pévèle, contrée humide, argileuse et boisée. Le second est le Mélantois aux terres crayeuses et riches. Une vieille tradition attribue à Cysoing une église bâtie par Saint Martin en 386. Plus vraisemblable est l'existence d'un sanctuaire en 742.
Le couple fondateur de l'abbaye est illustre. Il s'agit d'Evrard, duc de Frioul en Vénétie, et de son épouse Gisèle. Cette dernière est la petite fille de Charlemagne et la sœur de Charles le chauve. Gisèle qui apportait en dot un domaine de 8000 hectares faisant partie du trésor impérial se préoccupa de doter la future abbaye. Le couple princier eut plusieurs fils. L'aîné, Bérenger, devint empereur d'occident et roi d'Italie. Le troisième fils, Abélard, reçut le domaine de Cysoing tandis que le cadet, Rodolphe, allait présider aux destinées de l'abbaye.
La chapelle du palais fut la cellule initiale de l'abbaye dont la date exacte de fondation est inconnue. En 870 l'édifice en voie d'achèvement reçut les reliques de Calixte I, un pape qui avait dirigé l'église de 218 à 222. L'abbaye achevée en 874 fut ainsi placée sous le vocable de Saint Calixte.
Le fondateur Evrard était mort en 867. Van Hende précise que le corps du saint abbé, transféré d'Italie à Cysoing, fut exposé dans une belle chasse" pour être honoré par la dévotion du peuple qui le réclamait comme saint". Les documents sont rares sur la période qui suivit la mort d'Evrard. Le monastère fut-il saccagé par les Normands ? Fut-il victime des guerres qui dévastaient la Flandre, Rien ne l'atteste.
En 1132, les chanoines primitifs furent remplacés par des chanoines réguliers de l'ordre de Saint Augustin, adoptant une vie communautaire et obéissant à un régime très sévère. En 1154, l'abbaye comptait une trentaine de chanoines et disposait de 2 succursales, l'une à N.D. de Beaurepaire, près de Douai, l'autre à Sainte Gertrude, près de Bruges.
Le destin de l'abbaye allait être lié en deux occasions à celle du roi Philippe Auguste.
En 1196, la reine Isambour, fille du roi de Danemark Wildemar, avait été répudiée par le roi de France. Elle demanda l'hospitalité à l'abbaye de Cysoing et y vécut dans les exercices de piété, "cherchant dans la prière une consolation à son sort malheureux. Rappelons que Philippe Auguste avait épousé en premières noces Isabelle, fille de Baudouin V, comte du Hainaut. Devenu veuf, il choisit pour seconde épouse Isambour. Sa troisième épouse fut Agnès, fille de Berthold IV, comte de Meran dans le Tyrol.
Le dimanche 27 juillet 1214, le roi de France fut victorieux de l'empereur Otton IV et de ses alliés, le roi d'Angleterre et le comte de Flandre Ferrand de Portugal, époux de la comtesse Jeanne de Flandre. La bataille de Bouvines marquait le triomphe décisif de la royauté capétienne.
L'abbaye toute proche reçut les blessés et les moines eurent à soigner les rescapés et à ensevelir les morts. Philippe Auguste vint dans la chapelle remercier Dieu de l'avoir protégé tout en faisant le vœu de bâtir une collégiale. Elle devait être fondée par son fils près de Senlis sous le nom de Notre Dame de la Victoire.
Au cours du XIIIè siècle, des difficultés financières amenèrent les barons de Cysoing à intervenir dans la gestion du temporel et l'abbé se vit contraint en 1268 de faire appel au comte de Flandre Guy de Dampierre pour une aide financière.
En 1393, un incendie ravagea en partie les édifices abbatiaux. Des aides furent accordées par Philippe le hardi, le roi Charles VI et Jean sans peur.
En 1526, un homme exceptionnel fut élu abbé. Il s'agit de Mathias de Barda, qui favorisa pendant 40 ans une vie spirituelle approfondie et une vie intellectuelle brillante malgré les guerres de religion et les méfaits des gueux et des iconoclastes. Dès la fin du XVIè siècle, l'abbaye devint un lieu privilégié pour les grandes manifestations de piété. On y célébra les victoires de Charles quint. On pria avec ferveur Saint Evrard et Saint Calixte.
En 1774, le guerre de succession d'Autriche amena les troupes de Louis XV en Flandre. Le 12 mai, le roi était à Lille, le 14 il décida d'installer son quartier général à l'abbaye. On possède le récit du séjour royal grâce au témoignage de Don Wartel qui précise les logements distribués aux personnages de la cour. Le monarque aurait admiré le parc tout en établissant des comparaisons avec celui de Versailles. Après avoir tenu chapître des chevaliers du Saint Esprit, Louis XV quitta les lieux le 17 mai pour poursuivre sa campagne en Flandre maritime.
Le 2 mai 1745, le roi reçut du maréchal de Saxe la nouvelle qu'une tranchée avait été ouverte devant Tournai. Le 11 mai, l'armée française gagnait la sanglante bataille de Fontenoy, suivie le 23 mai de la prise de Tournai. De nombreux blessés furent soignés dans les hospices lillois tels que l'hospice Comtesse, l'abbaye reçut également des soldats blessés.
Au milieu du XVIIIè siècle, l'abbaye resta puissante avec ses 123 hectares de terre et ses 170 hectares de bois. Le 13 février 1790 un décret supprima les ordres religieux. Les moines refusèrent de prêter serment et trouvèrent asile à l'abbaye d'Hasnon tandis que des moines bénédictins venu d'Anchin et de Saint Amand trouvèrent asile à Cysoing.
Le 17 août 1792, l'abbaye fut vidée de ses livres, meubles et tableaux qui furent dispersés. En octobre 1793, les français, dans leur allégresse, incendièrent l'édifice. L'antique splendeur de l'abbaye rendit le dernier soupir lorsque furent aux enchères publiques les 60 parcelles composant l'enclos abbatial.
Après le départ du roi Louis XV, les moines de l'abbaye avaient souhaité l'érection d'un monument commémorant les événement de 1744 et 1745. Un projet fut soumis au monarque qui donna aussitôt son accord. Une pyramide fut inaugurée le 24 mai 1751 en présence des autorités du pays. Le peuple qui avait souffert du passage des troupes et de leur combats ne partagea guère l'enthousiasme officiel.
![]()
L'obélisque pyramidal élevée au centre du parc abbatial est toujours visible avec ses trois inscriptions latines concernant le séjour du roi, son passage en revue de l'armée et son retour victorieux. Les statues entourant l'obélisque ont disparu de même que deux dauphins placés au-dessus des consoles.
Conclusion
La présentation d'un jeton frappé en 1661 nous a permis de remémorer l'histoire d'une des plus importantes abbaye de Flandre par sa richesse, son prestige et l'éclat des événements glorieux dont elle fut le témoin.
En cette fin de XXè siècle, il ne subsiste de cette splendeur passée qu'une modeste pyramide érigée sur un lieu qui vit défiler princes, barons, pèlerins, manants et mendiants.